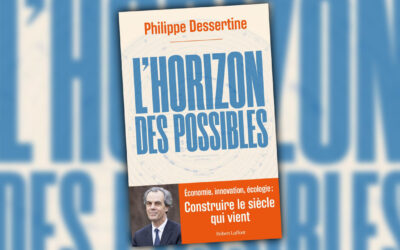Par Michel Leblay, patron d’émission à Radio Courtoisie ♦ La décision du président Donald Trump de transférer l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, entraînant par voie de conséquence, aux yeux de chacun, la validité d’une nouvelle capitale d’Israël, fait beaucoup de bruit. Radio Courtoisie consacre même un Libre Journal à cet événement, et Polémia en a reçu une des notes préparatoires dont elle fait bénéficier ses lecteurs.
Polémia
Le mercredi 6 décembre, le président Donald Trump a annoncé le transfert à Jérusalem de l’ambassade des États-Unis en Israël. Cette décision n’est qu’une application de la loi du 23 octobre 1995, le Jerusalem Embassy Act, votée par le Congrès. Le gouvernement américain était appelé à transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, reconnue comme la capitale de l’État d’Israël. Trump a ainsi franchi le pas capital qui traduit dans les faits la volonté de la classe dirigeante américaine et probablement d’une large partie de la population sans que cette dernière soit pour autant particulièrement préoccupée par les questions touchant à la politique étrangère. Ni Bill Clinton, président en 1995, ni George Bush, ni Barack Obama ne s’étaient risqués à suivre la résolution du Congrès. Néanmoins, le prédécesseur de Donald Trump avait déclaré dans une allocution prononcée en juin 2008 devant l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), important groupe de pression des juifs américains : « And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided » (Jérusalem restera la capitale d’Israël et elle doit rester non divisée).
Il faut se rappeler que, six mois exactement avant l’annonce de la Maison-Blanche, le 6 avril 2017, le ministère russe des Affaires étrangères publiait un communiqué aux termes duquel « La Russie réaffirme son attachement aux principes approuvés par l’ONU pour un règlement du conflit israélo-palestinien, avec Jérusalem-Est comme capitale du futur État palestinien. En même temps, nous devons affirmer que, dans ce contexte, nous considérons Jérusalem-Ouest comme la capitale d’Israël. »
En effet, depuis la première guerre israélo-arabe de 1948 et l’accord israélo-jordanien signé sous l’égide de l’ONU, le 3 avril 1949, Jérusalem est officiellement divisée en deux parties : l’ouest étant une partie prenante du territoire israélien ; l’est avec la mosquée Al-Aqsa et le Mur des Lamentations relevant alors du royaume de Jordanie. Les deux secteurs étaient séparés par une ligne de démarcation ou « ligne verte ». Les tentatives de l’ONU pour aboutir à un statut international de la ville restèrent vaines. La partie est de la ville fut conquise par l’armée israélienne durant la Guerre des six jours déclenchée le 5 juin 1967. Depuis lors, la Jordanie ayant perdu la région de Cisjordanie, située à l’ouest du Jourdain, la question de la création d’un Etat palestinien et de sa capitale se pose de manière récurrente. Car Jérusalem n’est pas une ville comme une autre : le judaïsme y trouve ses origines, le christianisme y est né et les musulmans qui conquirent la ville au VIIe siècle en firent leur troisième lieu saint avec l’édification de la mosquée Al-Aqsa.
En droit international, l’annexion de la partie est de la ville par Israël n’a pas été reconnue. Les ambassades demeurent à Tel Aviv et la Russie, qui entretient par ailleurs d’excellentes relations avec Israël, a refusé le transfert de son ambassade en le subordonnant à un accord entre Israéliens et Palestiniens sur le statut de la ville.
Si les considérations d’ordre intérieur ont certainement été déterminantes dans la décision de Donald Trump, il importe d’en mesurer les conséquences internationales et d’abord au Proche-Orient.
Il est fort probable que la position américaine ne fera que renforcer l’animosité d’une grande part du monde musulman à l’égard des États-Unis. Néanmoins, auprès des capitales, il faut prévoir un retentissement mesuré. Depuis 1995 et le vote du Congrès, la géopolitique de la région a été profondément bouleversée. Nous sommes loin du conflit israélo-arabe et des quatre guerres qui l’ont jalonné (1948, 1956, 1967, 1973). Le panarabisme qu’incarnait Nasser a définitivement sombré avec les Printemps arabes de 2011. L’islamisme et l’Iran sont devenus les facteurs de cristallisation des oppositions dans la région.
L’Arabie saoudite, fief du sunnisme le plus radical, est, au moins, l’allié objectif d’Israël dans la volonté de faire front face à l’Iran. Les deux États craignent l’emprise croissante de Téhéran dans la région et la formation de ce croissant chiite évoqué en 2004 par le roi de Jordanie Abdallah. Si un conflit direct avec l’Iran demeure hypothétique, Israël redoute la force représentée par le Hezbollah, bras armé de l’Iran au Liban, aguerri par sa participation majeure au conflit syrien. Déjà en 2006, il se montra un redoutable adversaire pour Tsahal, l’armée de l’État hébreu. Pour l’Arabie saoudite, l’Iran est l’ennemi à abattre. Elle s’y oppose en Syrie où elle appuie les groupes islamistes ; elle a rompu avec le Qatar, suspecté de proximité dans ses relations avec l’ancien empire Perse (le Qatar partage un immense gisement gazier dans le Golfe persique) ; enfin, elle s’est engagée dans une intervention hasardeuse au Yémen pour contrer une rébellion houthiste supposée recueillir le soutien de Téhéran. Riyad, dont les relations avec les États-Unis avaient été plus distantes du temps de la présidence de Barack Obama qui, le 14 juillet 2015, avait conclu l’accord sur le programme nucléaire iranien a reçu un appui renouvelé de la part du nouveau président américain. En visite dans la capitale saoudienne, le 20 mai dernier, il a notamment déclaré que l’Iran est le fer de lance du terrorisme mondial.
L’Iran chiite n’est pas indifférent à la cause palestinienne. Il apporte un soutien au Hamas, mouvement sunnite et à l’origine proche des Frères musulmans avec lesquels il aurait officiellement pris ses distances en mai dernier.
Si la Turquie condamne l’initiative américaine, son implication dans le conflit syrien et sa préoccupation vis-à-vis des Kurdes ne l’inciteront guère à aller au-delà de la réprobation diplomatique.
Quant aux Palestiniens, les premiers concernés, ils sont d’abord divisés entre l’Autorité palestinienne, née des accords signés à Washington le 13 septembre 1993, entre Israël et l’OLP, dont le pouvoir s’exerce en Cisjordanie, et le Hamas, maître de la Bande de Gaza. Il semblerait que la population palestinienne éprouve une certaine lassitude vis-à-vis de sa représentation politique. La position américaine pourrait être un nouveau facteur de mobilisation.
Si la création d’un Etat palestinien indépendant est défendue par les chancelleries, sa constitution effective est encore lointaine. Outre l’opposition israélienne, des difficultés essentielles demeurent : la séparation en deux entités territoriales, la Cisjordanie et Gaza qui relèvent de pouvoirs distincts et loin de s’accorder malgré des rapprochements apparents ; l’absence de ressources économiques qui engendrent nécessairement un lien de dépendance ; enfin, les autres États musulmans sont-ils prêts à laisser aux Palestiniens le contrôle du troisième lieu saint de l’islam situé à Jérusalem ?
Face à ce nouvel élément de confusion dans un Proche-Orient ravagé par les conflits, lieu de convergence des oppositions et des concurrences d’intérêts entre les grandes puissances de ce monde, l’une des questions est la place que doit y occuper la diplomatie française. L’action de celle-ci ces dernières années, dominée par l’idéologie et l’alignement sur les États-Unis, a été particulièrement déplorable. Le recul de l’Amérique dans la région comme le rôle de la Russie qui est une partie prenante majeure du conflit syrien offre à la France l’occasion de retrouver une place dans le jeu mondial. À condition aussi qu’elle s’affranchisse de toute politique menée au nom de l’Union européenne.
Michel Leblay
10/12/2017
Correspondance Polémia – 11/12/2017
Crédit photo : Walkerssk via pixabay (cc)

 Soutenez Polémia, faites un don ! Chaque don vous ouvre le droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don, profitez-en !
Soutenez Polémia, faites un don ! Chaque don vous ouvre le droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don, profitez-en !