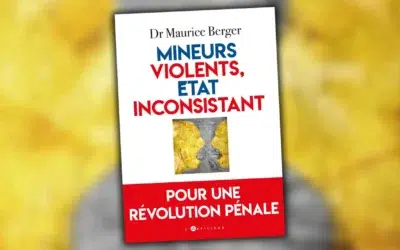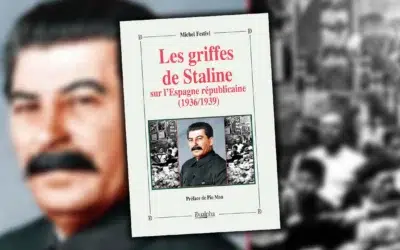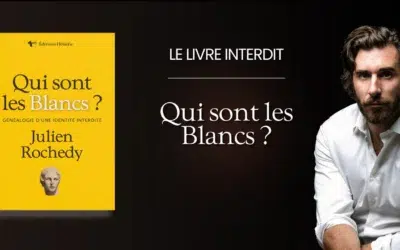Par Johan Hardoy ♦ Guillaume Travers est un jeune professeur d’économie bien connu de Polémia, puisqu’il est formateur de l’Institut Iliade et contributeur de la revue Éléments. Dans un opuscule dense et synthétique à la lecture agréable – Corporations et corporatisme -, il nous propose une réflexion sur un type d’organisation du travail issu du Moyen Âge, tout en se gardant de toute tentation irréaliste visant à restaurer un passé idéalisé.
Les corporations jusqu’à la Révolution
Guillaume Travers retient deux influences majeures sur l’origine des corporations qui apparaissent dans les villes à partir du renouveau urbain du XIe siècle, à savoir les premières communautés villageoises et les modes de vie communautaire du monde germanique. En effet, les corporations ne se réduisent jamais à un rôle purement économique car ce sont également des communautés de vie et de célébrations religieuses et rituelles, dotées d’un saint patron et, parfois, d’armoiries ou d’oriflammes.
À cette époque, la pratique du travail, entourée de rites, de traditions et de célébrations, est inséparable de l’apprentissage long et exigeant d’un métier dont l’accès est restreint. Il est ainsi interdit d’embaucher l’apprenti d’un confrère, de travailler la nuit, de faire de la publicité et d’attirer des passants dans sa boutique ! Les crieurs de Paris ne peuvent quant à eux annoncer qu’un enterrement par jour « afin que chacun ait des besognes par égale portion ». Toute tentative de travail dissimulé, au rabais, ou de spéculation sur les prix, est poursuivie.
L’auteur souligne la nécessité de se départir d’un regard moderne en considérant que les corporations ne sont pas des institutions cherchant à maximiser la production, le profit ou la consommation, mais visent un équilibre au service du bien commun, où les différentes communautés sont pensées comme complémentaires et non antagoniques.
Avec le temps, les rois tentent de s’immiscer dans la vie des corporations. Au XVIIe siècle, confrontée à des difficultés budgétaires, la monarchie commence à vendre l’accès à la maîtrise, entraînant peu à peu une rigidification d’un système fondé sur l’excellence technique et qui repose désormais davantage sur la fortune.
Au XVIIIe siècle, les corporations sont perçues comme des entraves à la liberté individuelle par les adeptes du libéralisme montant, qui défendent une conception individualiste faisant primer l’individu sur toute appartenance collective. En France, la première tentative pour les supprimer vient d’un ministre de Louis XVI, Turgot, en 1776. Les protestations sont alors si nombreuses que celui-ci est renvoyé et les corporations rétablies.
Lors de la Révolution, où, selon l’idéal proclamé, rien de doit subsister entre l’individu et l’État, c’est en 1791 que les corps de métier sont officiellement dissous par la loi d’Allarde, alors que la loi Le Chapelier interdit toute association patronale et ouvrière.
Guillaume Travers considère qu’il s’agit là d’un bouleversement de l’ordre social, niant toutes les formes d’enracinement et d’appartenance intermédiaires : les hommes deviennent des citoyens abstraits, égaux et substituables. Désormais, c’est le principe du marché qui prévaut.
La naissance du corporatisme moderne
Après 1815, la révolution industrielle, née en Angleterre, gagne le continent européen et entraîne le déclin du petit artisanat et l’essor de la grande entreprise (appelée « corporation » en anglais mais sans aucun rapport avec la corporation médiévale). Les ouvriers sont désormais fondu dans une masse et le patron devient lointain.
L’expansion démographique et l’exode rural entraîne un basculement vers une civilisation urbaine. C’est à ce moment que naît le « travail » comme concept abstrait, par opposition à une « œuvre » ou un « art » particulier.
La précarité de la condition ouvrière fait alors naître nombre de préoccupations sur la « question sociale », liée également à un besoin de re-socialisation, puis favorise l’émergence d’un mouvement ouvrier mieux organisé au sein duquel les doctrines de « lutte des classes » prennent de l’ampleur.
Néanmoins, le souvenir des corporations reste présent et des artisans tentent de reconstituer des groupements d’intérêts collectifs qui prennent notamment la forme de sociétés de secours mutuel et du compagnonnage.
En 1864, l’abolition du délit de coalition autorise la grève, puis, en 1884, la loi Le Chapelier disparaît du fait de la légalisation des syndicats.
Dans une très large mesure, la pensée corporatiste moderne se développe alors en réaction à la doctrine de la lutte des classes, en refusant, d’une part, de penser le tissu social comme le lieu d’affrontements irréductibles (chacun devant « tenir son rang »), et, d’autre part, de ne le considérer que sous le seul angle « matérialiste » des seules revendications économiques.
L’un des fondateurs du catholicisme social, René de La Tour du Pin (1834-1924), avance que l’homme n’existe que par des communautés, à commencer par la famille qui est « la molécule essentielle du corps social » et dont les autres découlent, des villages, quartiers, métiers, etc., jusqu’à la nation. Le libéralisme et l’individualisme sont condamnés pour leur rôle dissolvant. En 1891, le pape Léon XIII s’inspirera de ses écrits lorsqu’il publiera l’encyclique Rerum novarum, fondatrice de la « Doctrine sociale de l’Église ».
De nombreuses autres pensées corporatistes se multiplient en Europe jusqu’aux années 1930, que ce soit dans l’Action française et les courants monarchistes, les « non-conformistes des années 30 » unis autour du rejet de la prédominance des valeurs marchandes dans les rapports sociaux, chez le Belge Henri de Man ou chez des penseurs allemands ou autrichiens influencés par le mouvement romantique et hostiles au déracinement engendré par le capitalisme. Ce foisonnement intellectuel atteint son paroxysme à la suite du krach boursier de 1929, vécu comme une faillite de l’économie libérale.
Des régimes fascistes ou autoritaires, en Italie, au Portugal et en France, s’approprient alors les idées corporatistes. En Italie, Mussolini se déclare partisan de la construction d’un État corporatif dès son arrivée au pouvoir en 1922, mais ce n’est qu’en 1934 que les corporations sont instituées de manière généralisée et placées sous le contrôle d’un Conseil des corporations dans lequel l’État est omniprésent. Avec le déclenchement de la guerre, ce dirigisme est encore renforcé.
Sous le régime de Vichy, la Charte du travail de 1941, sous la houlette de René Belin (antérieurement un des principaux responsables de la CGT), est guidée par l’idée d’un dépassement de la lutte des classes par l’instauration de corporations par branches d’activités, permettant notamment la fixation des prix et des salaires sous le contrôle de l’État. Les syndicats sont dissous, alors que la grève et le lock-out patronal sont interdits. Un salaire minimum est prévu, mais cette mesure n’entrera jamais en vigueur. Certaines de ses réalisations ont survécu à la guerre, à l’image de l’Ordre des médecins.
L’auteur juge donc ces expériences corporatistes du XXe siècle peu convaincantes, notamment parce qu’elles ont cédé le pas à un dirigisme économique qui ne leur a laissé qu’une autonomie de façade. De nombreux penseurs avaient au contraire insisté sur un « corporatisme d’association », avec des associations de métiers recréées spontanément au niveau local, par opposition à un « corporatisme d’État ».
Une idée d’avenir ?
Guillaume Travers estime néanmoins que le corporatisme n’est pas mort et qu’il pourrait redonner un sens au travail d’aujourd’hui, caractérisé par le nombre croissant de « jobs à la con » et l’explosion des « burn out », selon deux expressions américaines.
Selon lui, davantage qu’une institution à rétablir, la corporation pourrait servir d’idéal régulateur : celui d’un monde de communautés, où le travail confère un statut, où il n’est pas considéré comme une pure marchandise et où l’activité économique est dotée de sens.
Le sujet est en effet à l’ordre du jour, avec la montée en puissance des idées localistes qui prônent la mise en place de circuits plus locaux et plus courts dans les activités agricoles ou artisanales. En effet, le corporatisme est par nature un esprit de provinces et de petites patries qui doit s’épanouir localement avec une intervention minime des États.
Une idée qui plairait bien au Gilets jaunes, sur lesquels nous proposerons prochainement une note de lecture.
Johan Hardoy
18/03/2021
« Corporations et corporatisme », de Guillaume Travers, aux éditions de La Nouvelle Librairie (69 pages, 7 euros).
- Hausse de la violence des mineurs : que faire ? - 31 octobre 2025
- Gauche et droite : deux morales distinctes - 25 octobre 2025
- Odes au Kazakhstan d’un ministre poète - 20 octobre 2025


 Soutenez Polémia, faites un don ! Chaque don vous ouvre le droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don, profitez-en !
Soutenez Polémia, faites un don ! Chaque don vous ouvre le droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don, profitez-en !