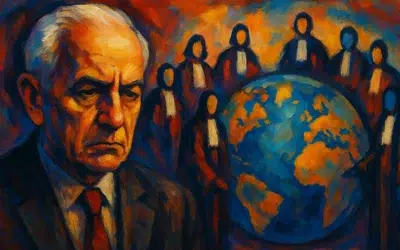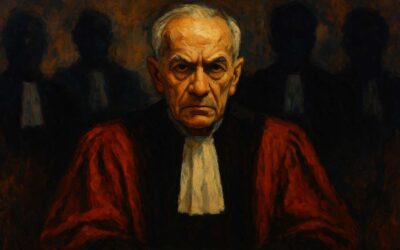Comme Samuel Huntington, dans Qui sommes-nous ?, l’avait pressenti, l’immigration a changé la nature des États-Unis. Reste à savoir comment les communautés de cette polyarchie ethnique vont parvenir à vivre en société ensemble ? Comment parviendra-t-elle à imposer de nouveaux impôts à ceux qui les payent alors qu’ils ont de moins en moins de choses en commun avec ceux qui en bénéficient ? Pour le professeur Gérard Dussouy les turbulences de la mondialisation atteignent désormais les États-Unis.
Dans une étude qui a presque vingt ans, Michaël Lind divisait l’histoire sociale, culturelle et politique des États-Unis en trois périodes (Lind, 1995). Aux « deux premières républiques américaines » de l’Anglo-Amérique (1788-1861) et de l’Euro-Amérique (1875-1957) avait succédé, selon lui, une « Fédération de races » de moins en moins cohésive malgré l’existence réaffirmée d’une culture américaine. Née de l’adoption des lois sur les droits civiques (années 1960-1970), puis confortée par l’Affirmative Act (à savoir la politique des quotas qui favorise l’accès des ressortissants des communautés non blanches aux emplois publics et privés, à l’enseignement secondaire et supérieur), cette « troisième république», vient, on peut l’écrire, d’être consacrée par la réélection de Barack Obama. Celle-ci donne raison à Lind, parce qu’elle est symbolique des nouveaux rapports de forces sociodémographiques qui caractérisent une société américaine de plus en plus multiculturelle, par suite d’une immigration intense. Obama a été réélu, même s’il existe d’autres causes inhérentes aux faiblesses du parti républicain et aux aspects rétrogrades de son programme, grâce à l’alliance des minorités, y compris les Blancs les plus nantis qui sont à l’abri de toute catastrophe économique, contre le vieux stock européen.
Maintenant, la question qui se pose est de savoir comment va fonctionner cette polyarchie ethnique (Blancs, Noirs, Latinos, Asiatiques, musulmans, etc.), qui signifie aussi la fin du leadershipanglo-saxon, lui qui a évité, dans le passé, la transposition aux États-Unis des antagonismes européens et qui leur a imprimé leur style diplomatique.
Les turbulences de la mondialisation sur le sol américain ?
Après avoir voulu formater le monde à son image, en s’ouvrant démesurément à lui pour mieux le conquérir, l’Amérique ne risque-t-elle pas, faute d’y avoir perdu sa culture politique homogène, de subir toutes les turbulences de la mondialisation sur son propre sol ?
La question est d’autant plus d’actualité que le changement politique et culturel s’accompagne, comme le redoutait Lind, d’une « brésilianisation » (*) des États-Unis. Il faut entendre par là, outre la fin de la suprématie de la population blanche et la reconnaissance du pluralisme culturel, toute une série de phénomènes qui vont compliquer la résolution des problèmes financiers et sociaux, et qui, à terme, pourraient affaiblir la puissance américaine.
L’immense responsabilité de Bill Clinton
Le premier phénomène est celui d’un retranchement exacerbé des catégories sociales qui ne se limite pas à un séparatisme spatial, mais qui se manifeste par une privatisation systématique des services, ce qui équivaut, pour les plus nombreux, à cause de la faillite de l’État fédéral et de nombreuses villes, à la privation de ces derniers. Le premier mandat d’Obama a été ainsi marqué par une régression sociale inconnue aux États-Unis depuis les années trente. Il faut dire qu’il n’en est pas le premier responsable. Le mal vient de la mandature de William Clinton qui a commis une double faute. D’une part, il a autorisé l’adhésion de la Chine à l’OMC et a ouvert le marché américain à l’afflux des produits chinois ; il en a résulté un déficit commercial américain abyssal et la désindustrialisation des États-Unis. D’autre part, il a fait supprimer la séparation des banques d’affaires et des banques de dépôts, en vigueur depuis 1933. Une telle décision a relancé toutes les activités spéculatives et elle est à l’origine du grand endettement des ménages américains. Sur le moment, et c’était l’effet recherché par Clinton pour se faire réélire, le pouvoir d’achat des Américains s’en est trouvé amélioré : ils pouvaient s’endetter et acheter des produits importés à bas prix. Au final, les États-Unis ont connu les deux krachs de 2007 et 2008, et de nombreux quartiers des villes américaines n’ont, aujourd’hui, pas grand chose à envier aux favelasbrésiliennes…
Le deuxième phénomène est l’accroissement considérable des inégalités sociales (1% de la population détiendrait 80% des richesses), de la paupérisation (26 millions de personnes au chômage ou sous-employées ; 1 personne sur 8 vit de bons alimentaires), et, toujours en rapport avec les faillites des collectivités locales et l’affaiblissement du pouvoir fédéral (contrairement au discours de la droite extrême), la dégradation accélérée des services publics. Une économiste américaine a dressé un bilan désolant de la situation (Huffington, 2007). Pourquoi et pour qui de nouveaux impôts ?
C’est à la lumière de ce contexte économique et sociétal que le débat sur la réforme fiscale, qui vient de s’ouvrir, prend tout son sens. Certes, à son origine, il y a l’intérêt général de réduire la dette, sous peine de coupes budgétaires automatiques. Mais, sachant que les classes moyennes blanches seraient les principales contributrices aux nouvelles recettes, ce débat sera un test. Il va montrer à quel niveau se situe la solidarité nationale dans une société éclatée comme celle des États-Unis. Le pourquoi et le pour qui de nouveaux impôts sont plus difficiles à légitimer quand les liens sociétaux et intergénérationnels se défont, quand, à l’intérieur d’une même population, des groupes humains considèrent qu’ils n’ont plus beaucoup en commun. Si aucun accord n’intervient, la fuite en avant (le relèvement du plafond de la dette) permettra, seule, de retarder les effets de l’anomie sociale…
L’élargissement de la polyarchie ethnique à de nouveaux groupes va se traduire aussi, en parallèle avec l’affaissement du leadership anglo-saxon, par une révision des choix et des préférences, lesquels relèvent souvent de l’affectivité, en matière de politique étrangère. Si le changement ethnoculturel en cours éloigne, sans aucun doute, les États-Unis de leurs sources et de leurs affinités européennes, il ne leur procurera pas forcément de nouveaux repères sur l’horizon mondial.
Ceci pourrait avoir l’avantage d’entraîner un désengagement américain du continent européen (en obligeant les Européens à regarder la réalité géopolitique en face et s’assumer au plan stratégique), tant il est devenu clair que pour Obama la relation avec la Chine est devenue primordiale. Néanmoins, il ne faut pas se cacher que les sollicitations intérieures multiples et divergentes rendront moins lisible qu’auparavant l’action extérieure des États-Unis.
Gérard Dussouy
Professeur émérite à l’Université de Bordeaux
15/11/2012
(*) Note de la rédaction : à rapprocher de la citation d’Eric Zemmour, à propos de la France, qui, selon le journaliste, encourt le même risque : « C’est la « brésilianisation » qui nous menace : ségrégation raciale, milliardaires à foison et appauvrissement de la classe moyenne. Misère du monde aux portes des antiques cités. La Défense sera notre Brasilia. Et la Seine-Saint-Denis, nos favelas.»
Bibliographie
- Michaël Lind, The Next American Nation. The New Nationalism and the Fourth American Revolution, New York, The Free Press, 1995.
- Arianna Huffington, L’Amérique qui tombe, Paris, Fayard, 2011.

 Soutenez Polémia, faites un don ! Chaque don vous ouvre le droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don, profitez-en !
Soutenez Polémia, faites un don ! Chaque don vous ouvre le droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don, profitez-en !